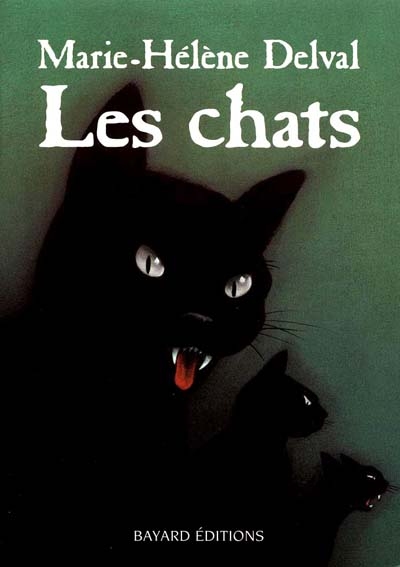« J’aime que mes lecteurs aient peur »

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) est une nouvelliste, romancière et journaliste argentine. À l’âge de 22 ans elle publie son premier roman, qu’elle décrit aujourd’hui comme « un mélange d’Emily Brontë et d’Anne Rice, avec un soupçon de Stephen King, d’Hubert Selby Jr et de Brett Easton Ellis ». Elle publie par la suite deux courts romans et deux recueils de nouvelles, dont Ce que nous avons perdu dans le feu, édité en français en 2017 et en cours de traduction dans dix-huit pays. Les histoires de cette ex-punk oscillent entre fantastique, horreur et réalisme ; ses thématiques sont urbaines, résolument modernes. Les Artisans de la Fiction l’ont interviewé à propos de son approche de l’écriture durant les Assises Internationales du Roman 2017.
Les Artisans de la Fiction : Par quoi commencez-vous pour écrire une nouvelle : une idée, un personnage, une fin, une image… ?
Mariana Enriquez : Pour moi les romans sont basés sur les personnages, et les nouvelles sur les idées. Les personnages y sont secondaires, presque des prétextes. Les nouvelles peuvent aussi servir à communiquer une ambiance, une humeur ; certaines sont comme des chansons, courtes et mémorables, avec un rythme constant. Mais dans mon cas, leur point de départ est toujours une idée.
Pouvez-vous donner un exemple de votre manière de procéder, avec une des nouvelles de votre recueil ?
Prenons la nouvelle Pas de chair sur nous. C’est l’histoire d’une femme amoureuse d’un crâne. L’idée, c’est de parler de la façon dont les femmes tombent amoureuses du concept de leur propre disparition. C’est une histoire d’anorexie, mais je ne voulais surtout pas d’une histoire réaliste, type reportage ou récit personnel… Je voulais quelque chose de plus « fun », qui puisse évoquer la folie de ce genre de comportement. Donc l’histoire est à la fois drôle et macabre. Mais l’idée, c’est de parler d’à quel point il est cinglé de souhaiter ne plus avoir de chair, de souhaiter disparaître.
Les fins de vos nouvelles sont souvent très fortes, car imprévisibles. C’est dû à la façon dont vous gérez les informations : le lecteur s’imagine une chute, mais il se trompe toujours. Comment travaillez-vous vos fins ?
Quand je commence à écrire, grosso-modo l’histoire est déjà en place dans ma tête. En général je connais déjà la fin. Si certaines fins sont imprévisibles, c’est parce que je déteste les choses trop propres, trop parfaites, en particulier dans les nouvelles. Je recherche l’imprévisible ; ça ne fonctionne pas toujours, mais quand je considère que c’est le cas je conserve la nouvelle. C’est en partie en réaction au nombre de nouvelles que j’ai lu où la fin est prévisible : pour moi c’est un réel problème technique.
Peut-être que certains lecteurs apprécient cela, mais je pense que les nouvelles pâtissent de cette idée répandue selon laquelle elles doivent être « bouclées ». Beaucoup d’écrivains, comme Lydia Davis, écrivent des nouvelles qui sont des fragments temporels ; je ne sais pas comment mieux le définir.
Une nouvelle peut même être un poème en prose… Pour moi la nouvelle moderne n’est plus celle du 19ème siècle, au sens où l’entendait Maupassant. J’adore Maupassant, mais je pense qu’aujourd’hui les nouvelles peuvent aller dans de nombreuses directions. Vers l’intertextualité, par exemple, comme dans les récits post-modernes. C’est plus libre qu’avant.
Techniquement, oui ; mais l’effet que les écrivains tentent de produire reste le même : quand on arrive à la fin, il faut que ce soit fort. Et vous y parvenez dans une grande partie de vos nouvelles. Ce n’est pas juste logique… Ça l’est, mais c’est aussi imprévisible.
Merci.
Réécrivez-vous beaucoup ?
Pas tellement, mais je corrige beaucoup. Pour les nouvelles en particulier, j’ai souvent une idée très précise de ce que je souhaite accomplir, donc la langue doit toujours être retravaillée.
Vous avez la nouvelle entière en tête avant de vous mettre à écrire ?
Oui. Je réécris beaucoup les romans, mais pas tant les nouvelles.
Parlons de violence. Est-ce difficile pour vous d’écrire certaines scènes ?
Non, j’aime écrire les scènes violentes et macabres. C’est difficile d’un point de vue technique, car je dois utiliser les mots qui vont provoquer une réaction précise chez le lecteur. C’est une chose que j’ai apprise en lisant énormément. Il y a aussi un problème, quand on écrit de la fiction de genre : c’est que certaines choses ne plairont pas à certains lecteurs ou ne leur feront pas peur…
Moi par exemple j’ai peur des chiens ; si on me fait lire une histoire de chien j’aurais très peur, mais quelqu’un qui aime les chiens ne comprendra pas. Ça, c’est un problème. Mais ce sont des difficultés techniques, pas émotionnelles. Quand j’écris je suis très éloignée des choses horribles qui se passent dans l’histoire, émotionnellement parlant. Si c’était un trauma au moment où c’est arrivé, ça ne l’est plus au moment de l’écriture. Je ne suis pas le genre d’écrivain qui « combat ses démons » en écrivant… Moi je les combat bien avant. Quand je m’assieds pour écrire, c’est un travail plaisant ; ce n’est pas du tout une catharsis.
Y’a-t-il des situations ou des idées qui sont si terribles que vous devez attendre pour pouvoir les écrire ?
Bien sûr. Pour avoir le courage d’écrire certaines choses, je dois laisser passer du temps. Mais cette dimension émotionnelle est loin derrière quand je m’assieds pour écrire. Je ne pense pas qu’on puisse écrire lorsqu’on est en plein milieu d’un tourment émotionnel… Enfin, peut-être que certains le peuvent, mais pas moi.
Je ne pense pas que ce soit possible.
Si on a encore la tête dedans, ça risque de sonner cucul-la-praline.
Cette confrontation à vos peurs avant l’écriture, cela fait-il partie de vos motivations pour écrire ?
J’imagine, oui.
Avez vous peur d’écrire certaines choses ?
Oui. Par exemple beaucoup de mes histoires parlent de corps, et de culpabilité. Ce sont deux choses qui me hantent : la peur de tomber malade, la peur de faire quelque chose de très mal et de devoir en subir les conséquences, d’être accusée… Ces choses m’effraient, elles me touchent émotionnellement, et ce sont des thèmes psychologiques qu’on retrouve dans mes textes.
Quelle effet ou émotion souhaitez-vous provoquer chez votre lecteur ?
J’aime que mes lecteurs aient peur. Moi-même en tant que lectrice cette sensation m’excite. Mais il y a un deuxième effet, plus tardif, que j’essaye de provoquer… C’est une technique que j’ai apprise en lisant de très bons auteur de genre, que ce soit en SF, en roman noir ou en horreur. Ces auteurs peuvent être très distrayants tout en écrivant sur des sujets très contemporains, qui concernent directement notre quotidien. Très politiques, donc. Mais c’est en quelque sorte un effet secondaire. Par exemple, dans les années 1940, quand tu lisais Raymond Chandler tu essayais de deviner qui était le meurtrier, mais quand tu refermais le livre, tu réalisais que tu avais lu un roman sur une société américaine corrompue, où les flics étaient des pourris et où obtenir la justice était impossible à cause de ce système dirigé par des bandits.
Mais ces choses, tu ne les remarquais qu’après coup ; pendant la lecture, tu n’y pensais pas, car tu étais pris dans l’intrigue. Voilà ce que je souhaite accomplir : d’abord une sensation forte, un frisson ; ensuite, une réflexion. Pour reprendre l’exemple de l’histoire du crâne, tu peux la lire et prendre du plaisir, mais quand tu la termines, tu penses à cette femme qui désire être extrêmement mince, ressembler à un squelette… Mais ça vient après.
La plupart de vos histoires paraissent fantastiques, mais au fond elles sont très réalistes.
Quand la violence survient on ne sait jamais si elle est surnaturelle, si elle a juste lieu dans l’imagination du personnage, ou si c’est juste l’ambiance qui crée ce feeling fantastique. Une de mes histoires, Toile d’araignée, parle de deux femmes argentines qui se rendent au Paraguay avec le mari d’une d’elles, qui disparaît. Dans cette nouvelle, en raison de différents indices que je plante discrètement, le lecteur en vient à penser que le mari disparaît à cause de la femme… Ou de quelque chose en lien avec la géographie, avec le pays lui-même…
Mais la façon dont j’agence les mots, dont je raconte l’histoire, dont je suggère les choses, tout cela amène le lecteur à penser que c’est une histoire d’horreur, de fantôme.
Comme si le pays dévorait les gens, les prenait au piège, comme une toile d’araignée. Mais je fais aussi allusion aux traumas politiques, au fait qu’en Argentine et au Paraguay des gens ont longtemps disparu pour des raisons politiques. Ce mélange d’éléments donne à l’histoire les apparences d’une nouvelle horrifique, mais la question reste ouverte : peut-être le mari s’est-il juste enfui. Mais la façon dont j’agence les mots, dont je raconte l’histoire, dont je suggère les choses, tout cela amène le lecteur à penser que c’est une histoire d’horreur, de fantôme.
Souvent dans vos nouvelles le lecteur ou le personnage a peur d’une chose, mais ce qui finit par arriver en est une autre. L’une de vos histoires les plus réussies est celle avec le point de vue masculin (« Pablito Clavo un clavito » : une évocation du Petiso Orejudo). C’est une des plus horribles, parce que le père désire vraiment enfoncer ce clou dans le crâne de son enfant… Et même s’il ne va jamais le faire, il le désire vraiment… Ce mec est loin d’être une victime (rires).
C’est sûr (rires). Si je devais écrire une suite, je ne pense pas qu’il enfoncerait ce clou dans le crâne de l’enfant, mais son désir est bien réel…
C’est pour ça qu’il voit ce fantôme… C’est quelque chose qui est en lui… Ce n’est pas un trauma comme dans la plupart de vos autres nouvelles.
C’est vrai.
Parlons des points de vue. Comment les choisissez-vous ? Certaines de vos nouvelles sont à la première personne, d’autres à la troisième.
C’est lié à l’idée qui sous-tends la nouvelle, et à sa tonalité générale. Si j’ai besoin d’une voix spécifique, j’utilise la première personne. Par exemple la première histoire du recueil, L’enfant sale, nécessitait d’être écrite à la première personne, car je voulais une narratrice ambiguë, qui pense que vivre dans un quartier chaud la rendra plus forte, mais qui réalise que ce n’est pas si simple. Pour transcrire cette ambiguité j’avais besoin d’écrire à la première personne. Et pour la nouvelle éponyme, celle qui clôt le recueil, c’est un peu pareil.
Les événements de cette nouvelle sont très violents, très extrêmes, et je ne voulais pas d’un point de vue trop rapproché ; il ne fallait pas que la narratrice fasse partie du groupuscule, car cela aurait requis une voix bien spécifique, que je n’étais pas forcément capable d’écrire car je n’étais pas sûre de la cautionner. Mais je ne voulais pas non plus écrire complètement à la troisième personne, car ça aurait été trop éloigné des événements, comme de les décrire de façon détachée…
le point de vue est parfois dicté par l’idée qui sous-tends l’histoire : en général si je veux une histoire ambiguë, j’ai besoin d’écrire à la première personne.
Alors j’ai choisi une narratrice à la première personne qui connaît le groupuscule, qui lui est lié et le comprends, mais qui n’y adhère pas totalement. Elle doute. Elle peut en raconter l’histoire car tout le monde veut qu’elle le rejoigne (en tout cas sa mère et les gens du groupuscule le veulent), mais elle a des réserves, et c’est pourquoi elle a besoin d’expliquer au lecteur ce qui se passe, comment ça a commencé, ce qu’elle en pense et ce qu’ils veulent qu’elle fasse. Mais je ne voulais pas de quelqu’un qui soit converti, qui fasse partie du groupuscule à 100%… Donc le point de vue est parfois dicté par l’idée qui sous-tends l’histoire : en général si je veux une histoire ambiguë, j’ai besoin d’écrire à la première personne.
C’est en lien avec la distance émotionnelle que vous souhaitez instaurer.
Je pense, oui.
Comment avez-vous appris à raconter des histoires ?
En lisant beaucoup. Je ne suis jamais allée dans un atelier, ni dans une fac de creative writing.
Y’en a-t-il en Argentine ?
Non. Enfin ces deux dernière années certaines universités s’y sont mises, mais c’est très récent. La plupart des argentins qui veulent écrire vont dans des ateliers animés par des écrivains. Ils se lisent les uns les autres, se corrigent, etc… Mais moi je n’y suis pas allée.
La plupart des écrivains à qui on pose cette cette question répondent « en lisant beaucoup ». Ok, mais encore faut-il lire comme un écrivain, c’est à dire pas juste pour le plaisir.
C’est vrai. J’ai publié ma première nouvelle à 20 ans. Aujourd’hui j’en ai 43. Cela fait donc longtemps que je lis comme une écrivaine. Je remarque comment l’auteur débute l’histoire, quel point de vue il utilise… Mais je peux toujours lire pour le plaisir. Je pense que si on lit seulement pour apprendre la technique, quelque chose se perd. Il faut prendre du plaisir dans la littérature, se laisser être surpris par elle, être fasciné par le langage et ce qu’il peut accomplir…
On tire forcément quelque chose de cette expérience, même sans y faire attention, on en tire des outils… Donc ça dépend. Quand un auteur me fascine, en général je ne peux pas voir ses « trucs ». C’est comme un rêve. Par exemple quand j’ai lu Méridien de sang de Cormac McCarthy, sa langue était si incroyable que je ne pouvais que m’y noyer, vouloir le terminer au plus vite ou au contraire vouloir que ça dure éternellement, mais en tout cas c’était une expérience d’immersion totale. Dans de tels cas, je ne veux être qu’une lectrice.
Avez-vous lu l’écrivain japonais Abe Kōbō ?
Oui, je l’apprécie beaucoup.
La façon dont il mélange la réalité et l’allégorie est intéressante. Parfois c’est totalement poétique, mais la plupart du temps c’est un mélange. J’ai pensé à lui après avoir lu vos nouvelles, car on ne peut y séparer la réalité du fantastique. Les deux y sont intimement liés…
C’est vrai.
Vous avez aussi été comparée à Roberto Bolaño…
C’est un écrivain que j’admire, mais en tant qu’auteurs je ne pense pas que nous ayons grand-chose en commun. Nous partageons une chose qui a peu à voir avec le style : l’intérêt pour la politique. Mais je pense que c’est une chose fatalement latino-américaine (rires). Si tu prends deux auteurs latino-américains et que tu les rassembles, ils parleront forcément de politique. Cela fait partie de notre réalité, et donc de notre fiction. Mais à part ça, je pense que Bolaño est un écrivain beaucoup plus « littéraire » que moi. En l’occurrence il est beaucoup plus influencé par Borges que moi. Alors qu’il n’est pas argentin, et qu’il était romancier avant d’être nouvelliste. Mais cet intérêt pour l’invention de bandes de poètes qui n’existaient pas, de biographies d’auteurs imaginaires… Tout cela est très « borgesien », et même si j’aime beaucoup le lire, ce n’est pas quelque chose que j’aimerais écrire.
Il avait l’esprit d’un encyclopédiste.
C’est une littérature aux dimensions épiques. Moi, même si j’écris quelque chose de très long, je vais le retravailler et couper jusqu’à ce que ce soit très court (rires). Je ne sais pas comment Bolaño travaillait, mais il me semble qu’il ne retirait jamais rien. Ce n’était pas son truc. Et ça fonctionne parfaitement comme ça, c’est très torrentiel…
Quel conseil donneriez-vous à un écrivain débutant ?
Je dirais qu’il faut essayer de lire et d’écrire dans un genre qu’on aime. Ensuite on peut expérimenter d’autres choses ; mais au début, mieux vaut tenter quelque chose qu’on connaît. Beaucoup de jeunes écrivains essaient de faire des choses qu’ils ne connaissent pas. Par exemple j’ai une amie qui aime la littérature russe, et pas juste les classiques… Mais quand elle écrit, elle tente d’avoir une écriture très minimale, presque comme des haïkus, quelque chose de japonais, ce qui est à l’opposé total de ce qu’elle lit. Alors forcément, ça ne fonctionne pas, car les outils qu’elle tente d’utiliser ne sont pas ceux avec lesquels elle est familière.
Elle aimerait les connaître mais ce n’est pas le cas, elle n’est pas familière avec ce genre de langage, de mélodies… Attention, je ne dis pas qu’elle devrait écrire un roman de 1000 pages comme les Russes, mais elle devrait essayer quelque chose de plus psychologique, de plus centré sur les personnages, sur la politique, sur les relations entre les gens… Quelque chose de moins délicat. Parce que pour écrire comme elle le souhaiterait, il faudrait qu’elle passe beaucoup de temps à lire Hemingway et Carver et des auteurs japonais qui correspondent à ce style… Toute cette école minimaliste. Donc voilà le conseil que je donnerais : si vous avez beaucoup lu les auteurs minimalistes, essayez de faire comme eux. Quoi qu’il en soit, travaillez dans un style que vous connaissez.
___________________
Ce que nous avons perdu dans le feu est publié aux Editions du sous-sol (http://www.editions-du-sous-sol.com)
Interview : Lionel Tran
Avec d’énormes remerciements à Adélaïde Fabre, programmatrice des Assises Internationales du Roman
Les Artisans de la Fiction remercient Alexandre Simon pour avoir bénévolement attiré notre attention sur le recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, en avoir assuré la transcription et la traduction.