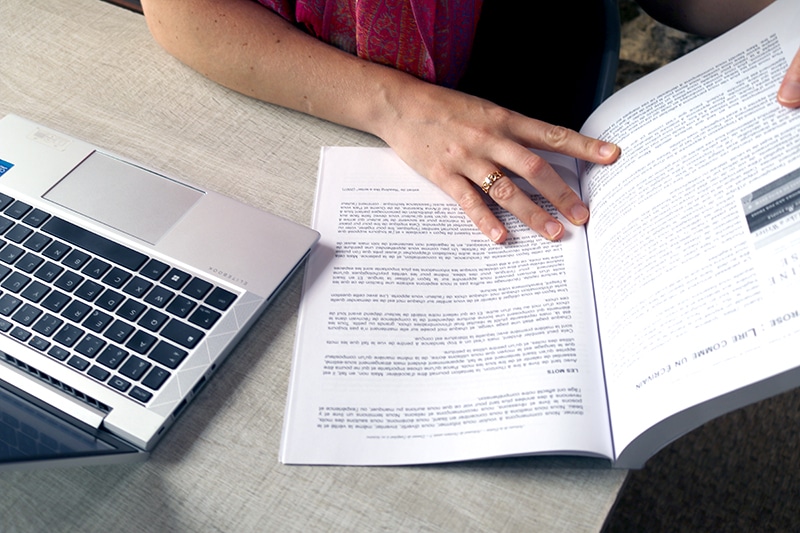Pourquoi l’apprentissage de l’écriture a t-il été radié de l’université française ? Comment en sommes-nous venus à mépriser l’apprentissage classique des formes de narration ? Pourquoi leur avons-nous préféré le commentaire et l’analyse de texte ? Nous revenons dans cette interview de Violaine Houdart-Merot sur les conséquences de ces partis pris.

Violaine Houdart-Merot est l’une des figures de proue de la création littéraire en France. Elle est l’instigatrice du master de création littéraire et du doctorat de recherche en création de l’Université de Cergy-Pontoise. Et aussi auteur du livre La création littéraire à l’université. Elle partage avec nous son regard et son expérience sur le déclin de l’apprentissage de l’écriture à l’université.
L’apprentissage de l’écriture à l’université : un peu d’histoire
Pourquoi a-t-on cessé d’enseigner l’écriture en France depuis la fin du 19ème siècle?
Violaine Houdart-Merot : « L’écriture qui a cessé progressivement d’être enseignée et pratiquée à la fin du XIXe siècle, c’est celle de l’enseignement rhétorique, aussi bien dans le secondaire qu’à l’université. L’enseignement rhétorique, dans le prolongement de la pédagogie jésuite, était fondé sur la traduction et sur l’imitation des œuvres étudiées, essentiellement gréco-latines. Ces œuvres comprenaient aussi bien des discours d’orateurs que des tragédies, des épopées ou des ouvrages philosophiques et historiques. La finalité de la lecture était alors d’apprendre l’art d’écrire et de parler. On pratiquait différents genres : des discours, des vers en latins, des lettres ou des narrations par exemple. Cet apprentissage s’appuyait aussi sur des traités de rhétorique. »
Pourquoi avoir fait le procès de la rhétorique ?
V H-M : « D’abord la défaite contre l’Allemagne en 1870 qui amène à remettre en question le système éducatif français. On le juge trop peu scientifique et moins performant que le système allemand. Ensuite le nouveau contexte scientifique : le positivisme de la fin du XIXe siècle et la recherche d’une légitimité des études littéraires par le recours à la science, au moment où se développe l’histoire littéraire. C’est enfin une conception romantique de la création littéraire. Elle se méfie de toutes sortes d’imitation au nom de l’originalité et du génie créateur.
Cet enseignement rhétorique avait certes bien des défauts. Mais on a jeté en quelque sorte le bébé avec l’eau du bain, en abandonnant tout apprentissage d’une écriture autre que celle du commentaire. Les seuls exercices qui ont remplacé ces différents exercices rhétoriques avaient pour finalité la lecture : la composition française ou dissertation et l’explication de texte. En sorte que la seule écriture pratiquée dans l’enseignement secondaire a été une écriture de type critique. Une écriture du commentaire et non de même nature que les textes littéraires étudiés. »
Quel a été, pour vous, les conséquences de l’abandon d’un apprentissage basé sur l’imitation et l’appropriation des modèles classiques ?
V H-M : « La première conséquence de cet abandon fut de renoncer à un apprentissage diversifié des modalités d’écriture. Notamment d’écritures de type littéraire, au profit de la seule écriture critique. L’autre conséquence fut de dissocier l’acte de lire et l’acte d’écrire. Ce qui est aussi dommageable pour la lecture que pour l’écriture. En effet la pratique d’une écriture littéraire est souvent une incitation à lire. La lecture est devenue une finalité en soi des études littéraires, au lieu de privilégier une interaction entre la lecture et l’écriture.
Plus profondément, il me semble que la perte d’attraction des études littéraires est liée à un enseignement qui ne permet pas une réelle appropriation de la littérature, du fait de ce clivage entre lire et écrire. Je pense, comme Jean-Marie Schaeffer dans sa Petite écologie des études littéraires, qu’il est indispensable de définir la littérature en terme d’ »usage esthétique ». Et pour cela il faut permettre à chacun, élève ou étudiant, enfant comme adulte, de pratiquer la littérature pour se l’approprier. »
Pouvez-vous nous parler de l’importance du mythe romantique dans le rapport à l’écriture, en France ?
V H-M : « Les romantiques ont voulu rompre avec le classicisme et la fameuse doctrine de l’imitation : « que le poète se garde surtout de copier qui que ce soit, pas plus Shakespeare que Molière, pas plus Schiller que Corneille », écrit Victor Hugo dans la Préface de Cromwell. Le mouvement romantique prône l’originalité et affirme que l’on crée, non pas à partir de ce qu’on a lu, mais en écoutant la nature, son cœur et son inspiration. Hugo affirme également que le poète « ne doit pas écrire avec ce qui a été écrit, mais avec son âme et son cœur ».
De là est né le mythe de l’écrivain démiurge, créant dans la solitude, à une époque où les écrivains revendiquent leur autonomie dans la société. Certes on sait bien que les Romantiques imitent comme tous les écrivains, reconnaissent même des modèles et que, si l’originalité est devenue une nouvelle catégorie esthétique, leurs œuvres sont tout autant que les autres nourries de leurs lectures. Ils réagissaient en fait contre une application trop rigide du principe d’imitation des Anciens et revendiquaient leur liberté par rapport à des normes d’écriture trop étroites. Mais le mythe a perduré. »
Comment expliquez-vous l’absence de remise en question du modèle français d’enseignement de la littérature, qui existe depuis presque 150 ans ?
V H-M : « Si ce mythe perdure, alors même que beaucoup d’écrivains contemporains revendiquent à nouveau l’imitation comme constitutive de la création, alors même que la notion d’intertextualité est presque devenue un nouveau lieu commun, c’est sans doute parce que ce mythe du génie littéraire ex nihilo correspond aussi à la place privilégiée, idéalisée que tient la littérature en France, conçue comme intouchable, inaccessible au commun des mortels.
Dans East Village Blues, l’écrivaine Chantal Thomas raconte comment, arrivant à New York au milieu des années 1970, elle fut stupéfaite de découvrir une ville où se pratiquent des lectures publiques et où l’on ose se dire poète sans avoir peur du ridicule. Alors qu’en France, à la même époque, le chemin vers l’écriture est « un mouvement vers l’impossible ».
Ce mythe perdure aussi, précisément, à cause de ce clivage entre lire et écrire. Parce qu’on ne pratique pas l’écriture à l’école, sinon dans les petites classes. La littérature étant réservée aux enfants ou aux grands écrivains. Il est difficile en France de sortir du « régime vocationnel » qui est celui des écrivains depuis le XIXe siècle. Selon lequel l’activité d’écrivain répond à une vocation, à un appel intérieur, comme dans le domaine religieux, régime de « singularisation » qui s’oppose au régime « professionnel », comme l’explique Nathalie Heinich dans L’Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique (2005). »
Vous êtes-vous penchée sur l’apprentissage de la littérature tel qu’il est proposé dans d’autres pays ? Si c’est le cas, les types d’enseignement proposés sont-ils différents du modèle français ?
V H-M : « En dehors de la France, et notamment aux États-Unis et au Québec, mais aussi en Grande-Bretagne et en Australie, le rapport à la littérature et à l’écriture créative est en effet différent. Ces modèles étrangers sont importants pour nous aider à penser une autre manière d’enseigner la littérature. Le modèle le plus connu est celui des programmes de creative writing. Le premier est apparu aux États-Unis dès 1936 dans l’université d’Iowa et ces programmes (et notamment les « masters of fine art ») se sont ensuite multipliés. Mais ces programmes ont été – et sont toujours – victimes de préjugés en France, souvent par méconnaissance. De même, au Québec, le doctorat en création littéraire est bien établi depuis les années 1980.
Alain Beaulieu explique qu’à l’université Laval, les premiers ateliers d’écriture sont nés de la demande des étudiants. Puis a été créé un parcours spécifique de création littéraire, y compris en doctorat. Les colloques internationaux que nous avons organisés depuis une dizaine d’années à l’université de Cergy-Pontoise nous ont permis de mieux comprendre ce qui se pratique à l’étranger. De même la thèse soutenue en 2013 par Amarie Petitjean, comparant le modèle français et les modèles canadiens et états-uniens éclaire leur histoire. Le doctorat que nous avons mis en place en France, dans quelques universités, s’inspire du modèle québécois de « recherche-création », tout en cherchant une voie plus spécifiquement française. »
Pensez-vous que l’on puisse enseigner l’écriture littéraire ?
V H-M : « Je suis convaincue qu’on peut enseigner l’écriture littéraire. À condition de concevoir cet enseignement non comme un ensemble de techniques et encore moins de « recettes » à transmettre. Mais comme un accompagnement qui permet à chacun tout d’abord d’oser écrire, de s’autoriser à écrire, et ensuite d’explorer l’écriture, par une interaction avec la lecture de textes littéraires variés et par un travail de réécriture.
Dans cette mesure, il ne s’agit nullement de revenir à l’enseignement rhétorique du XIXe siècle, mais d’inventer une nouvelle forme de « culture rhétorique », qui ne considère plus qu’il existe des règles universelles, transmises dans des traités de rhétorique à dimension prescriptive. Je conçois cet enseignement comme un laboratoire. Un lieu d’expérimentation littéraire où la dimension collective permet à chacun d’avoir d’emblée des lecteurs attentifs et exigeants et un regard critique sur ses écrits. Ce qui est très stimulant pour pouvoir retravailler ses textes, de même qu’à l’inverse on entraine chacun à être un lecteur plus expert. »
Depuis la publication de votre livre, La création littéraire à l’université, pensez-vous que la situation a beaucoup évolué en France ?
V H-M : « Il me semble que ces nouvelles formations intéressent de plus en plus les étudiants et les enseignants-chercheurs en littérature. Quelques masters ont été créés depuis la publication de mon livre en 2018. De nouveaux postes apparaissent ci et là sous la rubrique « création littéraire ». Plusieurs thèses et une première habilitation à diriger des recherches ont été soutenues depuis trois ans, sous la mention « Pratique et théorie de la création littéraire ». Et par ailleurs, des recherches théoriques sont menées actuellement. En littérature mais aussi dans les autres arts sur cette articulation entre recherche et création. Nous allons d’ailleurs prochainement publier chez Peter Lang, Amarie Petitjean et moi-même, un ouvrage collectif, intitulé La Recherche-création littéraire. Il rassemble des écrivains, doctorants et enseignants-chercheurs, en France, mais aussi aux États-Unis, au Québec, en Grèce, en Suisse.
Mon espoir est que le secondaire aussi redonne davantage de place aux pratiques d’écriture créative. Elles sont peu présentes dans les nouveaux programmes. Car ils sont très axés encore sur le commentaire et la dissertation, même si l’on parle d’une écriture d’appropriation (qui risque d’être peu pratiquée, faute de temps). Il faut rappeler que bien des enseignants, en collège notamment, ont compris depuis longtemps l’intérêt de faire écrire les élèves et d’importer au sein de l’institution scolaire les pratiques d’ateliers d’écriture, même si le nombre d’élèves est un obstacle. Mais des revues comme la revue Pratiques ou Le Français aujourd’hui donnent depuis longtemps des pistes passionnantes pour cette appropriation littéraire par la pratique d’écriture. »
Que souhaitez-vous pour l’avenir de la création littéraire en France ? Comment participer à son expansion ?
V H-M : « Il y a toujours le risque qu’une réforme se rigidifie. Qu’elle se transforme en routine. Il ne faudrait surtout pas que ces nouvelles formations deviennent des cours de rhétorique dans le mauvais sens du terme. C’est-à-dire en se contentant de donner des techniques passe-partout. Sans être dans une perspective d’exploration et de travail de la langue. Sans être à l’écoute de la singularité de chacun. Il y a aussi le risque que ces formations soient prises en charge par des enseignants qui n’aient pas véritablement réfléchi aux enjeux de ces démarches et qui n’aient pas fait l’effort de se former.
De même les nouvelles thèses, si elles sont mal comprises, peuvent se réduire à un écrit créatif d’intérêt variable associé à un travail de recherche au rabais, sans interaction entre les deux. Pour cela, il importe d’être vigilant, de continuer à travailler collectivement sur ces questions. Je crois à l’intelligence collective dans ce domaine.
Mais il me semble important qu’il existe des structures en dehors de l’université ou de l’institution scolaire. Comme Les Artisans de la fiction, Aleph ou le Labo des histoires pour les enfants, qui offrent à des publics très variés la possibilité d’avoir accès à une écriture créative, à différents niveaux. Il ne faudrait surtout pas mettre en concurrence les différents lieux de formations à l’écriture créative. »
Un conseil pour les apprentis écrivains qui se découragent devant l’ampleur de ce qu’ils ont à apprendre ?
V H-M : « Je pense que le plus important est la force du désir d’écrire. C’est d’ailleurs l’un des bienfaits de ces nouveaux masters. Ils permettent à chacun de mesurer réellement l’ampleur de ce désir. Certains réalisent alors que ce désir n’est pas assez fort pour y consacrer vraiment tout le temps et l’investissement nécessaire.
Face à un étudiant découragé, qui a l’impression de ne pas avancer, je lui dirais de continuer à écrire. D’écrire le plus régulièrement possible. De lire, le plus régulièrement possible. Mais aussi d’écrire ses lectures : « Si vous n’arrivez pas à écrire, écrivez » disait le philosophe Wittgenstein. Il faut réamorcer régulièrement le désir d’écrire. On ne peut pas dissocier ces pratiques d’écriture de « savoirs » sur l’art d’écrire. Cela exige de lire, aussi bien des lectures littéraires que plus théoriques. Je pense aussi que les échanges sont importants. C’est aussi l’un des bénéfices de ces masters que de permettre la constitution de petites communautés, souvent très solidaires. Les étudiants s’entraident et se soutiennent entre eux, au-delà des deux années qu’ils ont passé ensemble. »
Pour aller plus loin
Nous remercions grandement Violaine Houdart-Merot pour cet entretien qui éclaire la question de l’apprentissage de l’écriture au sein de l’université française. Son point de vue permet ainsi de mieux comprendre les réticences que rencontre l’apprentissage de l’écriture en France.
Vous pouvez lire ici la seconde partie de cet entretien :
Le master de création littéraire – Interview Violaine Houdart-Merot
Cette interview vous permettra de mieux comprendre l’apprentissage de l’écriture proposé dans l’université française et d’évaluer si ces formations correspondent à vos besoins et attentes.
Si les questions d’enseignement de la littérature dans le système éducatif français vous intéresse, nous vous recommandons cet autre entretien :
Faut-il supprimer les études littéraires dans l’université française ?
L’apprentissage de l’écriture proposé par les Artisans de la Fiction diffère de l’ apprentissage de l’écriture développé au sein des masters d’écriture créative proposés par l’université Française. Nos formations partent du même constat, mais proposent de former nos élèves aux règles de la dramaturgie et à l’apprentissage des modèles narratifs. Nous organisons régulièrement des journées d’initiation pour permettre aux élèves de tester notre approche.