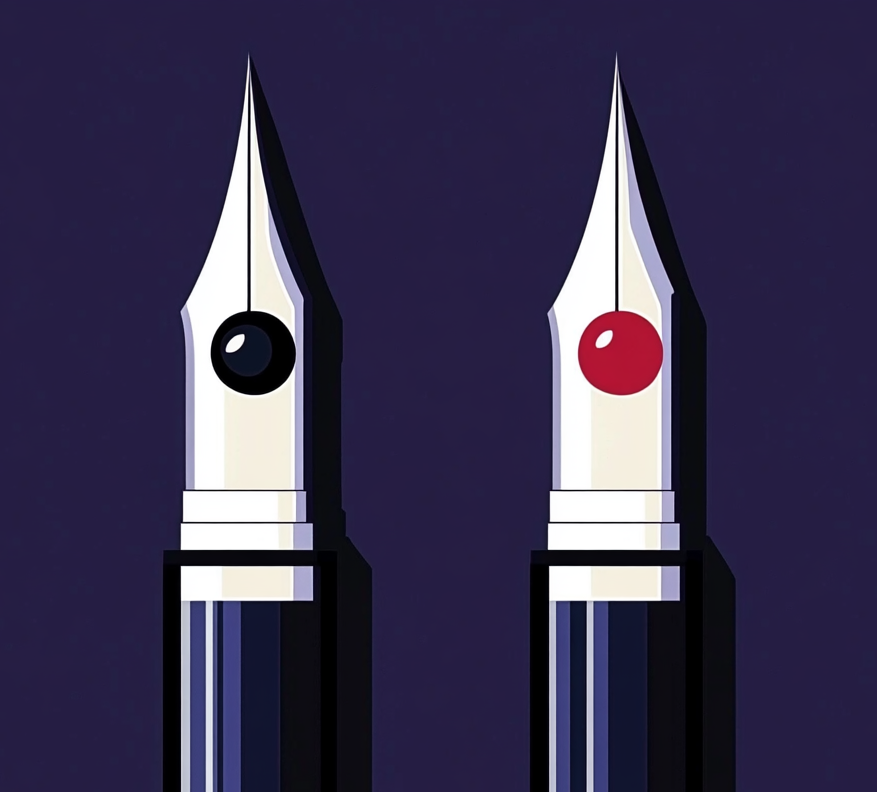« Sans bonnes histoires, il n’y a rien. » 
Est-il possible d’éditer des romans de genre en langue française et de trouver un public ? C’est l’aventure dans laquelle se sont lancées au Québec les éditions Alire, depuis 1996. Luttant pour exister à leurs débuts, les éditions Alire se sont depuis imposées dans le paysage éditorial québécquois.
Les Artisans de la Fiction : Existe-t-il des formations de narration littéraire en français au Québec ?
Louise Alain : Connaissez-vous l’ouvrage d’Elisabeth Vonarburg sur comment écrire des histoires ? C’est un des ouvrages les plus utilisés au Québec dans les cours d’écriture et de création littéraire. C’est un guide pour apprendre à écrire. Elisabeth Vonarburg est elle-même une grande écrivaine de science-fiction. Elle a longtemps donné des cours de création littéraire Elle a voulu écrire un livre très ludique. Ce livre est connu en France : à chaque fois que nous allons dans des salons des gens nous le demandent…
Je dis « nous » parce que, même si ce n’est pas nous qui l’avons publiés chez Alire, l’éditeur qui l’a publié il y a quelques années a fermé, et Elisabeth a récupéré ses droits d’auteur. Donc nous l’avons réédité parce que, même si ce n’est pas le genre de choses que nous publions habituellement, c’est un livre qui se vends bien, régulièrement, tous les ans… Il y a toujours une curiosité chez les gens, un désir d’apprendre à écrire. Ça a toujours été le cas.
Considérez-vous que raconter des histoires est un métier ?
Oui, ça s’apprends.
Dans notre petite école on voit un énorme appétit d’apprendre de la part des élèves.
Les gens écrivent beaucoup, publient beaucoup, mais j’imagine que l’écart entre tout ce qui s’écrit et tout ce qui est publié est très grand. Tout le monde n’écrit pas forcément pour publier.
Mais quand les gens découvrent les ficelles du métier, ils ne lisent plus de la même façon. Ça change pas mal de choses. C’est moins de la consommation.
C’est vrai.
Vous disiez que vous aviez commencé par vous occuper de la communication d’auteurs québécois non publiés au Québec.
Des auteurs comme Elisabeth Vonarburg, Jean-Jacques Pelletier ou Esther Rochon, pour n’en citer que quelques-uns, en fait ils publiaient au Québec de longue date, mais… Le problème, c’est que les québécois ne les lisaient pas. Ils ne savaient même pas qu’ils existaient, et ce pour une raison commerciale : les éditeurs locaux qui les publiaient essayaient de les vendre comme des « auteurs québécois ». Donc c’était de la science-fiction, mais en librairie c’était classé dans le rayon « littérature québécoise ». À cette époque il n’y avait pas cette conscience dans l’édition, dans l’industrie, que les auteurs qui faisaient du genre devaient être travaillés différemment.
Or quand l’amateur de science-fiction se rends en librairie, il ne vas pas dans le rayon « littérature québécoise » ; il va dans le rayon « science-fiction ». Idem pour l’amateur de romans policiers, ou fantastiques. À cette époque il n’y avait pas cette conscience dans l’édition, dans l’industrie, que les auteurs qui faisaient du genre devaient être travaillés différemment de ceux qui font de la littérature « blanche » ou « générale ». Alors voilà… En 1993 j’ai commencé à travailler dans une grosse boîte, Québec Amérique, où Jean Pettigrew a démarré pour la première fois au Québec une collection spécialisée dans les genres, où nous publiions des inédits au format poche, à petits prix donc, pour former le lectorat et lui permettre d’essayer nos auteurs.
En quoi consistait votre travail là-bas ?
Le plus gros travail que j’ai fait sur cette collection chez Québec Amérique, c’était de me rendre chez les libraires et de leur dire « Ok, vous avez reçu trois exemplaires de tel titre, quatre exemplaires de tel autre ; vous laissez un exemplaire au rayon québécois, et vous mettez tous les autres aux rayons polar, fantastique ou science-fiction. Je viens vous revoir dans un mois ou deux, et on fait le bilan. » Et ça a été pareil dans toutes les librairies : les livres classés par genre s’étaient vendus, les autres non. Alors voilà, nous avions fait la démonstration par A+B, et une fois que nous avons gagné cette bataille-là, deux ou trois ans plus tard nous avons monté Alire avec Jean Pettigrew. Et nous avons continué sur cette lignée : une maison d’édition spécialisée, qui publiait d’abord en format poche, et où les genres étaient bien identifiés. Et c’est comme ça que nous nous sommes fait notre place au Québec. Nous sommes très américains dans notre storytelling, mais nous sommes aussi de tradition française, alors nous nous distinguons.
C’est comme ça que nous avons pu vendre nos livres, en les mettant à 7 ou 8 euros, et c’est comme ça que la maison d’édition s’est installée… Puis avec le temps nous sommes aussi devenu une maison d’édition plus traditionnelle, mais ça a mis longtemps… Nous avons commencé à refaire du grand format en 2009, donc 13 ans plus tard. Mais dès le début nous savions que le grand format aliénait une partie des lecteurs.
A-t-il été difficile de convaincre les lecteurs que des auteurs québécois pouvaient écrire aussi bien que des anglo-saxons ?
Oh, oui. Moi qui fait souvent les salons du livre, j’ai souvent entendu des gens dire « C’est québécois ? Ça doit pas être terrible ! » Alors le doute était là. Mais nous disions aux gens d’essayer. J’ai même dit à des gens « Si vous n’aimez pas ce livre, revenez l’année prochaine et je vous le rembourse. » Mais personne n’est jamais venu se faire rembourser. Nous avons de bons auteurs, nous n’avons pas à pâlir devant les anglo-saxons. D’accord nous sommes très américains dans notre storytelling, mais nous sommes aussi de tradition française, alors nous nous distinguons. La littérature de genre au Québec possède sa propre couleur, sa propre Histoire ; nous avons nos territoires, une vision qui nous est propre, celle des francophones d’Amérique, qui se sont épanouis loin de la mère-patrie. Cette distance et cette originalité, je les revendique.
La littérature de genre au Québec possède sa propre couleur, sa propre Histoire. ; nous avons nos territoires, une vision qui nous est propre, celle des francophones d’Amérique, qui se sont épanouis loin de la mère-patrie
Aujourd’hui, est-ce différent ?
C’est beaucoup plus facile. Maintenant il y a des éditeurs qui font de la littérature de genre. Des collections « Polar », nous en avons vu émerger au Québec depuis le début des années 2000, parce qu’à un moment les éditeurs ont senti qu’ils loupaient quelque chose.
Il y a eu une explosion, une effervescence, une multiplication des éditeurs. Ce qui est une excellente nouvelle, parce qu’avant quand on disait « non » à un auteur, c’était comme si on signait l’arrêt de mort de son texte. Il n’y avait pas d’autres éditeurs avec une volonté de travailler les genres. Maintenant c’est beaucoup plus sain. Parce qu’il y a des livres que nous ne publions pas chez Alire, non parce qu’ils sont mauvais, mais parce qu’ils ne correspondent pas à notre ligne éditoriale.
Quelles sont vos exigences pour accepter un manuscrit ?
Il faut que ça marche. Que l’histoire fonctionne, qu’elle soit bien construite. Il faut que ce soit cohérent, qu’on y croit. La science-fiction, ce n’est pas tout et n’importe quoi : il y a des codes. Bien sûr on peut défaire les codes, mais pour ça il faut les connaître. Une fois qu’on connaît ces codes on peut jouer avec, les réinventer, faire bouger les choses.
Chez Alire nous avons la chance d’avoir quelqu’un qui connaît les genres. Jean Pettigrew est un collectionneur depuis sa plus tendre enfance, un boulimique de science-fiction, qui a aussi beaucoup travaillé ici en France. Il connaît tout le monde dans le milieu de la science-fiction depuis 40 ans, et il a toujours eu conscience qu’on pouvait faire quelque chose au Québec.
Un passionné ?
Oui, c’est la seule personne qui pouvait monter une maison d’édition comme la nôtre. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Quand on est parti ensemble de notre maison d’édition précédente, c’était un peu hasardeux parce qu’on mettait tous nos oeufs dans le même panier : si on se plantait, on était tous les deux sur la paille. Alors j’ai dit à Jean, « Ok, je peux te suivre sur ce projet, mais il faut que tu engages quelqu’un pour s’occuper de l’aspect commercial, des relations avec la presse, etc. Parce que si tu fais des livres et qu’ils dorment dans des boîtes, moi je ne miserai pas un sous sur ta compagnie. » Publier de bons livres, c’est une chose ; les faire vivre sur le marché, c’en est une autre. Alors voilà, je lui ai dit ça et ça l’a convaincu. On est un beau couple en affaires.
Pour finir, comment s’appelle le livre d’Elisabeth Vonarburg dont vous parliez au début ?
Une belle écriture, c’est bien, mais personnellement ça ne me suffit pas. Il s’appelle Comment écrire des histoires – guide de l’explorateur. Ça ressemble à une BD, c’est un livre très amusant. Il y a beaucoup de dessins, de schémas et de jeux. C’est un livre très ludique. Il permet d’apprendre à écrire via des exercices, en mettant en situation, en proposant différentes alternatives pour faire comprendre ce qu’est la mécanique de l’écriture. Parce que oui, c’est une mécanique
C’est ce que nous défendons aussi. Ce qu’on peux apprendre à des gens qui veulent écrire, ce n’est pas l’expression personnelle ; ce sont les règles, les principes de composition. C’est particulièrement nécessaire dans le genre, mais aussi dans la littérature générale.
Sans bonnes histoires, il n’y a rien. Une belle écriture, c’est bien, mais personnellement ça ne me suffit pas.
———-
Les Artisans de la Fiction ont interviewé Elisabeth Vonarburg à propos de Comment écrire des histoires
Le site des éditions Alire – La Page Facebook des éditions Alire (très riche et fournie sur l’actualité des éditions Alire)
Remerciements à Pierre Larsen pour le travail bénévole de transcription.
Remerciements à Gabriel de la Librairie Vivement Dimanche – A la Librairie du Tramway.
Interview : Lionel Tran