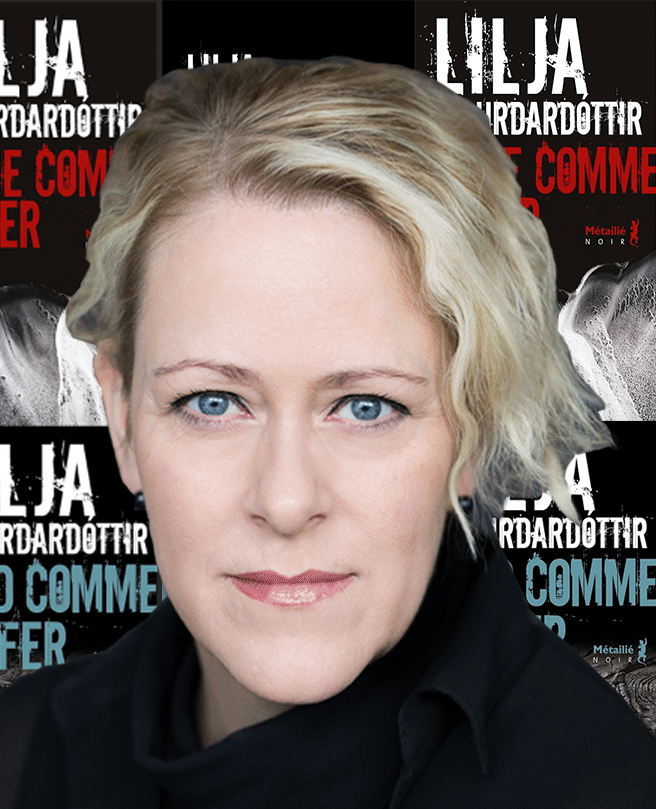« Avoir conscience du lecteur est important »

Matthew Neill Null est un romancier américain originaire de Virginie-Occidentale. Il a étudié le Creative Writing à l’Iowa Writers’ Workshop et ses nouvelles ont été publiées dans plusieurs anthologies, dont la Pen/O. Henry Prize Stories.
Le miel du lion, son premier roman, l’a imposé comme une nouvelle voix prometteuses dans le paysage littéraire américain. Il est aussi l’auteur d’un recueil de nouvelles, Allegheny Front, qui paraîtra prochainement en français chez Albin Michel.
Matthew Neill Null enseigne le Creative Writing à la Bryant University. Dans le cadre des Assises Internationales du Roman 2018, Il répond aux questions des Artisans de la Fiction concernant l’apprentissage de la narration littéraire, sa transmission et la mise en oeuvre des techniques du romancier quand on est un auteur atypique.
Les Artisans de la Fiction : Comment fonctionne une histoire ?
Matthew Neill Null : En termes de structure, je crois que la manipulation du temps est un savoir-faire essentiel. Pulsations, prolepsis, flash-back, les outils sont nombreux. Une grande part de l’écriture consiste à sélectionner les éléments à présenter au lecteur (images, dialogues, scènes…) mais aussi à décider de leur ordre. Pour ma part, penser structure revient à penser aux différents usages du temps.
Une grande part de l’écriture consiste à sélectionner les éléments à présenter au lecteur (images, dialogues, scènes…) mais aussi à décider de leur ordre. Vous savez, une histoire ce n’est rien, c’est juste de l’encre sur une feuille. Les personnages ne sont pas réels, rien n’est réel, donc vous utilisez les images, les personnages et le temps pour donner de la consistance au monde créé.
Quand j’analyse un roman, je prête attention aux grandes lignes de l’action, mais aussi au travail de pulsation : où sommes-nous dans la chronologie, combien de temps prend une scène, quand commence-t-elle, quand se termine-t-elle…
Et il m’arrive de me dire que tel ou tel élément aurait dû être amené dix pages avant…
Qu’est-ce qui vous fait préférer une scène à un résumé narratif ?
J’ai reçu d’un autre écrivain cet excellent conseil : une bonne scène c’est comme une fête.
Quand vous allez à une fête, vous voulez arriver le plus tard et de partir le tôt possible, n’est-ce pas ? Vous voulez profiter du meilleur de la fête. Vous ne voulez pas vous pointer à 8 heures et vous dire « mince, ceux qui devaient arriver plus tard sont déjà là et ça va être chiant », ou bien vous dire pendant la soirée « vivement que celui-ci finisse son verre et se barre… » Non. Ce que vous désirez, c’est arriver à la fête et vivre immédiatement le moment le plus intéressant et le plus excitant.
L’écrivain doit penser au lecteur et lui donner le meilleur de son matériau. Ne soyez pas non plus trop pointilleux sur les détails. Souvent le lecteur n’en a pas autant besoin que ce qu’on pourrait imaginer.
Je crois que la fiction fonctionne à son maximum lorsqu’on cible les moments les plus intéressants pour le lecteur. C’est évident, personne ne veut s’ennuyer en lisant.
Dans les ateliers d’écriture américains, on préconise parfois à l’excès de montrer au lieu de dire. Je ne suis pas d’accord avec ça.
En tant que lecteur, vous pouvez vouloir les deux. Quand on dit « montrer », il s’agit de scènes, de dialogues, d’actions et de causalité… Des moments où le lecteur découvre ce qui est en train de se jouer en même temps que les personnages. Dans ces moments-là, l’expérience du lecteur est très proche de celle des personnages.
« Dire » renvoie aux aspects d’exposition, de résumé, de survol des événements et du temps qui passe, et, dans un souci d’efficacité, vous pouvez en avoir besoin pour donner des informations au lecteur. Dans mon cas, où je décris l’évolution de personnages sur une longue période, ce serait dingue de vouloir tout montrer.
Vous avez besoin d’un équilibre entre les deux, et certains écrivains excellent là-dedans, je pense à Shirley Hazzard (The Transit of Venus) [1], Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo) [2], et Gabriel Garcia Marquez (Cien años de soledad)[ 3].
Je considère donc que l’affirmation « montrer plutôt que dire » est fausse. Mais d’un autre côté, les romans qui ne font que dire, dire, dire sans faire agir les personnages, ne sont pas satisfaisants. Il y a une juste mesure à trouver.
Qu’en est-il, pour vous, de l’enchaînement des séquences ?
Il n’est pas nécessaire que l’arrangement des séquences soit chronologique. Quelle que soit la façon dont vous organisez votre roman, vous devez être conscient du lecteur, et aller là où c’est le plus intéressant.
Parfois vous lisez un livre, et vous sentez que la narration n’a pas été assez façonnée. L’auteur veut vous donner tous les détails de l’expérience des personnages, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, et ça devient assommant.
Le travail de l’écrivain c’est de sélectionner, en toute subjectivité. Guerre et Paix n’est pas objectif, Tolstoï décide quoi vous montrer. Le point de vue omniscient à la troisième personne n’est pas plus objectif qu’à la première personne, il dénote une personnalité, et cela tient dans cette idée de sélection. En tant qu’auteur, je choisis de montrer une image plutôt qu’une autre au lecteur.
Avoir conscience du lecteur est important, car le roman de fiction est une des formes d’art les plus collaboratives. Lorsque l’on regarde un film, c’est différent : les images sont à notre disposition. Le lecteur, lui, est extrêmement sollicité, il doit construire les images dans sa tête, les dialogues, les personnages.
Ça prend beaucoup plus de temps d’écrire de la prose que de la lire. Mais c’est aussi là où réside le vrai plaisir de cette collaboration entre le lecteur et l’auteur.
Comment travaillez-vous sur vos romans ?
Une grande part du processus se fait inconsciemment, je pense… Je ne peux pas dire que je prépare l’esquisse d’une trame ou quoi que ce soit de ce genre, mais j’ai une idée claire de la façon dont l’histoire commence et comment elle finit.
Je ne suis pas à l’aise avec l’étiquette d’auteur de fiction, car contrairement à beaucoup d’entre eux, ma démarche ne commence ni avec les personnages, ni avec les situations ou les conflits.
Pour moi, le processus débute avec des images ou des bribes de langage. Je suis un écrivain sensible aux images, je fais des associations d’idées, ce qui s’approche davantage du travail de poète. D’ailleurs, la plupart des éditeurs qui ont publié mon travail ont été eux aussi poètes. J’apporte une grande attention à la langue.
Mon écriture recherche le mimétisme, vous savez, comme sur ces toiles où la pomme est si bien représentée que vous pourriez avoir envie de mordre dedans. Sauf que mon réalisme à moi ne se place pas sur ce terrain, je travaille sur un autre plan, davantage sur les associations d’images et le subconscient. Ce n’est ni bizarre ni fantaisiste, rien de comparable à Beckett ou Donald Barthelme. Je me situe peut-être entre le réalisme et « autre chose », en tout cas je n’écris pas « comme dans la vie ».
Du coup, avec votre approche poétique de l’écriture, il doit être préférable de choisir des structures d’histoires simples…
Souvent, le cœur de mes histoires est une situation amorale, dans laquelle mes personnages essaient de trouver ce qui est juste. Ils se retrouvent dans une posture difficile où un choix est nécessaire, et cela les amène à découvrir en eux une certaine ambivalence.
C’est le cas de mon roman Honey From The Lion[4], dont l’intrigue se passe au moment d’une grève, avec des personnages confrontés à des forces externes qui s’opposent à leurs aspirations. Je voulais une intrigue, du suspense et de la tension afin de trouver un équilibre avec le langage poétique et les images, et faire ainsi en sorte que la lecture du livre reste une expérience satisfaisante et plaisante.
Le langage que j’utilise peut vite devenir dense, complexe, et c’est sans doute pour cela que j’ai fait le choix d’une intrigue solide et enlevée.
L’intrigue est une bonne chose. Ce n’est pas pour rien que les gens aiment les histoires de Stephen King, les thrillers, le mystère, les liens de cause à effet, et les auteurs qui maîtrisent l’art de l’intrigue méritent le respect. Même un auteur de « littérature » doit garder à l’esprit que l’intrigue et les rapports de causalité sont importants pour le lecteur.
Si vous explorez ce langage poétique, n’y a-t-il pas un risque d’être hermétique ? Avez-vous des lecteurs à qui montrer vos étapes de travail ?
Désormais je me sens rassasié des retours et je cherche à finaliser mes textes par moi-même.
Vous savez, j’ai suivi pendant deux ans un programme MFA (Master of Fine Arts).Ces ateliers d’écriture ont pour principe de soumettre ses écrits à d’autres auteurs. C’est une expérience intense, très enrichissante.
Avant de suivre ce programme, j’écrivais de façon romantique, seul, en lisant des livres, sans personne pour lire mon travail. J’en ai tiré des leçons. Mais désormais je me sens rassasié des retours et je cherche à finaliser mes textes par moi-même.
Si je montre mon travail, c’est vraiment à la fin du processus. Mon agent littéraire a travaillé pendant trente ans dans la maison qui a édité Robert Stone et Philip Roth. Elle comprend mon style et c’est à elle que je soumets mon travail. Mais je le fais quand le travail est assez complet, car je suis prudent. J’essaie de parvenir à comprendre moi-même ma sensibilité, d’avoir mon propre discernement sur ce que j’essaie de faire. Mon style est en dehors des canons d’écriture actuellement en vogue aux Etats-Unis, et je ne tiens pas à ce que quelqu’un me dise : « je ne comprends pas ». Et c’est dangereux.
Je me souviens avoir écrit un texte qu’une dizaine de personnes ont détesté. Ils trouvaient que ma prémisse était folle, peu convaincante, que c’était trop philosophique.
Ça m’est arrivé en MFA. Je n’écrivais pas autant que les autres participants, et je me sentais un peu à la rue. Je me souviens avoir écrit un texte qu’une dizaine de personnes ont détesté. Ils trouvaient que ma prémisse était folle, peu convaincante, que c’était trop philosophique. Ils s’imaginaient peut-être que j’essayais de frimer, mais mon intuition c’était que je tenais quelque chose. Et c’est justement le côté déjanté de cette histoire qui a plu aux revues, ainsi qu’aux lecteurs.
La réaction du lecteur est importante.
Quelle est votre position sur les MFAs (Masters of Fine Arts / Masters de Creative Writing) ?
Je suis allé à celui de l’Iowa, parce que c’est historiquement un des premiers, et parmi les plus prestigieux.
Le personnel est conséquent, composé de 25 écrivains et 25 poètes. La principale aide qu’apporte un programme MFA et que tous les écrivains recherchent, c’est le temps. Le temps, c’est la meilleure chose que vous puissiez offrir à un écrivain. Le cursus dure trois ans, et j’ai eu de la chance d’avoir pu le suivre.
Les MFA apportent beaucoup en termes de structuration. Mais il y a des étudiants qui viennent pour se montrer, séduire, et pour un auteur entendre trop de voix différentes peut gêner pour trouver son propre style. De plus chaque université a également son style, et cela aussi peut être un danger, en termes de risque de formatage.
Soumettre un texte à la classe et le changer parce que tout le monde est contre, c’est dangereux parce l’auteur peut perdre quelque chose en route. Il vaut mieux aller dans ces MFA avec une vision déjà claire de ce qu’on propose, et se dire que les retours vont permettre d’enrichir cette vision, plutôt qu’appliquer la vision des autres à ses écrits.
Les MFA c’est comme tout le reste, il y en a des bons et des mauvais. Aujourd’hui peut-être qu’aux Etats-Unis, il y en a trop. Mais ce genre de cursus manque, sans doute, en Europe…
Ce que j’aime dans les MFA, c’est qu’ils cassent cette image romantique de l’artiste ténébreux, mystérieux qui d’un coup sentirait venir l’inspiration et écrirait des romans incroyables. Oui, dans le subconscient, le mystère et l’inspiration sont très importants, mais il y a des jours où écrire n’est pas glamour. C’est juste de l’artisanat, comme démonter une machine et réassembler des pièces pour se faire la main. Il y a beaucoup de tâches ingrates.
L’essentiel du travail d’écrivain, ce n’est pas d’attendre l’inspiration, mais de s’asseoir et faire, faire, faire en espérant que vous créez quelque chose. Ensuite vous remaniez de façon exhaustive. Bien sûr, il y a une part de génie, de talent, mais c’est une part infime en comparaison au labeur des mots.
Lire est un travail essentiel de l’écrivain. C’est comme vouloir être architecte. Vous avez besoin d’étudier les édifices dans le détail, d’apprendre comment se construit un immeuble. Je ne comprends pas quand mes étudiants me disent, pour justifier leur refus de lire les livres des autres, qu’ils préfèrent protéger leur voix. Les livres sont faits de livres. Sans Shakespeare, vous n’auriez ni Melville, ni Faulkner.
Comment se déroule l’apprentissage de la narration aux Etats Unis ?
Il est fréquent qu’un étudiant en commerce, en médecine ou en sciences se frotte à l’écriture. Cela fait partie de l’éducation universitaire. Certains essaient d’écrire de la poésie, des pièces de théâtre, des histoires courtes, mais dans un contexte artistique, pas critique. Les étudiants sont donc familiers du vocabulaire, des notions de structure, de point de vue, de métaphores, de comparaisons…
Dans mes classes, si je demande la différence entre le point de vue du narrateur omniscient et le point de vue de la première personne, 85% des étudiants connaissent la réponse. On peut donc en venir plus rapidement à d’autres aspects de l’artisanat, et je pense que c’est important de le faire dans un contexte créatif (artistique) et non critique.
Il s’agit de dire : ok les gars, on sort ses stylos et on dessine une montagne. Ça ne sera pas bon du premier coup, mais ce n’est pas grave, ça fait partie du boulot. C’est sûrement préférable de passer 6, 7 ou 8 ans à travailler sur la langue avant de produire un véritable ouvrage. On peut dire la même chose de la guitare, ou du sport, ou de tout ce qui nécessite de l’entraînement. Ça ne tombe pas du ciel. On s’auto intoxique avec cette idée du jeune génie qui crée son travail par la pure inspiration. Je n’y crois pas. Melville a étudié Shakespeare de près.
Quelles sont les aspects les plus importants sur lesquels vous faites travailler vos étudiants de creative writing ?
Le problème critique de mes étudiants, c’est qu’ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas de littérature. Pour leurs cours, ils consultent internet et les résumés d’intrigues. Ils écrivent des messages sur leurs téléphones, ils utilisent des media plus passifs, ils aiment Netflix, la télé. Ils veulent être écrivains mais ils sont plutôt fermés à ce qu’on leur propose.
En France, je vois un engagement pour la littérature, les gens sont de meilleurs lecteurs, lisent plus de livres. Mes étudiants usent et abusent des clichés, ils n’essaient pas de créer quelque chose de nouveau. Avec eux, je reviens sans cesse sur la structure des phrases, car beaucoup d’entre eux croient pouvoir s’affranchir de la grammaire et du sens, sous prétexte qu’ils font de l’art…
Je dis aussi à mes étudiants que je ne peux pas leur apprendre à écrire. Vous allez à l’université, et vous pouvez apprendre à être chimiste ou comptable. Mais l’écriture est un processus qui implique de l’engagement personnel. Pour être écrivain vous devez être volontaire, faire beaucoup de sacrifices et cela sans attendre le succès, car vous pourrez ne jamais être publié.
Par contre, je peux enseigner comment commencer à être un écrivain, comment apprendre à lire comme un écrivain, à penser comme un écrivain… Je peux leur enseigner comment commencer, mais je ne peux pas finir le processus à leur place.
Revenons à la façon dont vous travaillez sur vos romans. Vous dites ne pas vous appuyer sur les personnages, ni sur les situations… comment procédez-vous ?
C’est difficile à expliquer. Ce que je peux dire c’est que j’écris le premier jet en quelques mois, et ensuite je passe des années à réviser de façon exhaustive le sens, les paragraphes, je combine et j’ajoute des personnages… Mais mon point de départ est une situation plutôt squelettique, avec juste quelques tensions entre les protagonistes.
C’est dur pour moi de parler du processus car sur le moment je suis très impliqué. C’est comme demander à un poisson quel temps il fait. Tout ce que je sais c’est que je m’assois pour quelques heures avec des pages autour de moi.
Ça fait penser à la manière dont procède le sculpteur sur bois, en dégageant progressivement la sculpture du tronc à coups de gouge. Cela doit être un processus de réécriture extrêmement long ?
J’ai eu un professeur qui disait « on réécrit dans l’idée d’être relu ». J’accorde une grande importance à la langue. A la fin, la langue doit être un roc, il ne doit pas y avoir de faille. Les meilleurs romans, les meilleurs poèmes sont ainsi. Essayer de créer quelque chose de puissant est un acte important. Surtout dans un monde qui vous dit souvent que ce que vous faites est sans importance. Ce qui est particulièrement le cas en Amérique.
Aux Etat Unis, l’invention dans l’écriture est souvent considérée comme optionnelle, comme s’il s’agissait d’ornementation. On évoque sans arrêt les « canons », les règles universelles, comme dans les sciences de ingénierie, où les mathématiques, mais tout cela m’évoque quelque chose de froid, de mécanique, sans valeur s’il n’y a pas une expérience humaine derrière tout ça.
En France, il y a une déférence pour la littérature. C’est formidable. Il n’y a pas d’équivalent en Amérique. Là-bas, les romans font peur parce que l’art dérange. En Amérique, on veut bien l’art qui fait tapisserie, mais pas quand il choque ou quand il dérange. Pour moi, si vous vous contentez de créer juste de la décoration ou du divertissement, ce n’est pas de l’art. C’est beau, c’est joli, mais ça n’est pas vraiment pertinent. Même en littérature, la plupart des livres chroniqués sont plus proches du divertissement. Je n’ai pas de problème avec ça, nous en avons tous besoin, mais je pense que dans cent ans ou deux cent ans il ne restera rien de ces livres-là, plus personne ne s’en souciera.
——————–
[1] Publié en français sous le titre Le Passage de Vénus, traduit par Claude Demanuelli, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 2007
[2] Publié en français sous le titre Le Guépard, traduit par Jean-Paul Manganaro, Le Seuil, 2007
[3] Publié en français sous le titre Cent Ans de Solitude, traduit par Claude Durand et Carmen Durand, Le Seuil, 2007
[4] Publié en français sous le titre Le Miel du Lion, Albin Michel
Blog de Mathew Neill Null (en anglais)
Cours de Mathew Neill Null à propos de l’intrigue (48 mn – en anglais)
Entretien réalisé durant les 11èmes Assises Internationales du Roman (2018).
Interview : Lionel Tran.
Transcritption et traduction : Jean Nicolas Monier.
Remerciements : Isabelle Viot – Mathilde Walton.