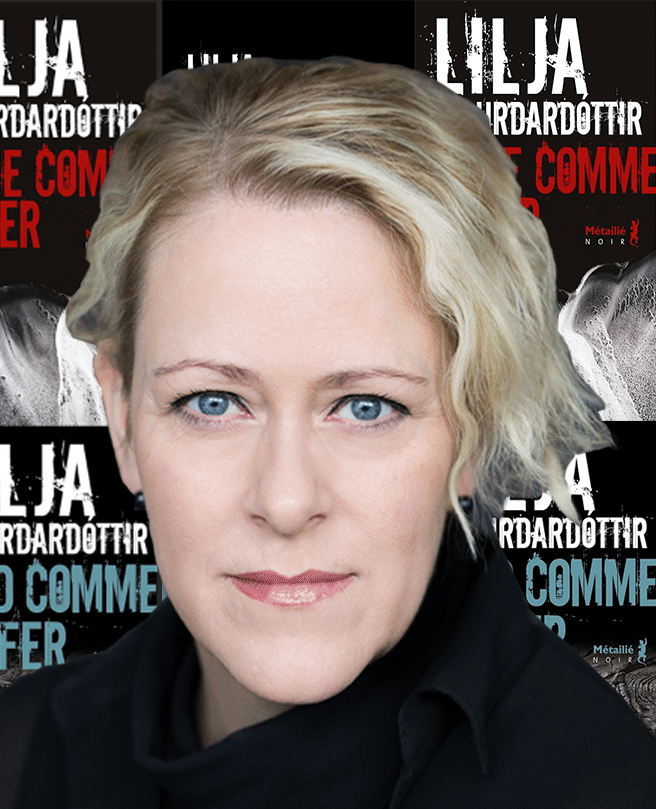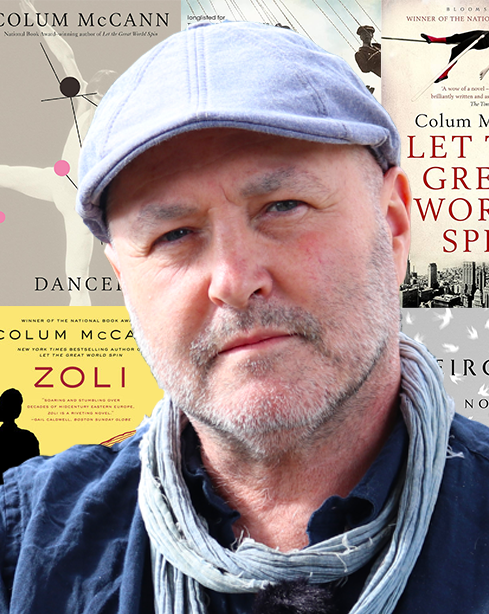A l’automne 2020, les éditions Allia publiaient un petit pamphlet intitulé « Le deuil de la littérature ». En à peine 100 pages, ce dernier démontait férocement l’indigence des études littéraires et philosophiques dans l’enseignement supérieur français. Et appelait tout bonnement à leur suppression… en rêvant d’une réforme de l’enseignement de l’écriture basé sur l’imitation des modèles dès l’école primaire.
L’auteur de ce pamphlet est normalien, professeur de littérature. Il s’appelle Baptiste Emile Dericquebourg et répond à nos questions.

Baptiste Emile Dericquebourg, pouvez vous nous présenter votre parcours ?
Après une prépa littéraire à Lyon, j’ai étudié quatre années à l’ENS de la rue d’Ulm, la philosophie d’abord, puis les Lettres classiques, ainsi que, pendant un an, le sanskrit à Vienne. Je suis ensuite parti en Grèce, où j’enseignais à l’Institut Français d’Athènes, puis j’ai enseigné en Français, au lycée, au collège, et depuis quelques années en prépa littéraire à Saint-Brieuc.
Quelles étaient vos attentes en tant qu’étudiant en vous inscrivant en Lettres ?
Je crois que j’attendais, assez naïvement, d’accéder à un savoir général et d’ordre supérieur, permettant d’agir. Une formation permettant de devenir un intellectuel. C’était naïf, cette figure est surannée, mais mes lectures étaient alors largement sartriennes et camusiennes… Aujourd’hui, je dirais toutefois que cette ambition, sur le fond, est celle qui apparaît dans le programme de formation du rhéteur Isocrate, et qu’elle est très banale : accéder à une pensée construite, en se confrontant à des textes, en apprenant à produire et à argumenter, à s’exprimer et bien agir. Elle peut être présente et accompagner bien des études avec des finalités professionnelles différentes, finalement…
Qu’est ce qui vous a poussé à écrire « Le deuil de la littérature » ?
La première version du texte a été écrite au moment du mouvement des GJs. Cet événement politique et le clivage sociologique qu’il a puissamment souligné m’a poussé à reprendre plusieurs fils de réflexion sur la “littérature”, son enseignement, le milieu universitaire, et a été comme un moment de cristallisation pour toutes ces réflexions, qui avaient toutefois commencé il y a une quinzaine d’années, dès ma prépa.
Il m’a semblé important de proposer une solution à un sentiment assez largement partagé de perte de valeur et d’effacement progressif du sens de ces études qui ne soit pas un rejet total, parce que tout en étant insatisfait de la manière dont s’organise l’enseignement de, et dont se déploie le discours sur, la littérature, il m’apparaît évident que l’accès au langage est une chose essentielle dans l’existence.

Vous dressez un double constat d’échec des filières universitaire d’enseignement de Lettres et de Philosophie. Pour vous, qu’est ce qui ne fonctionne pas, dans l’enseignement de ces filières ?
J’essaie d’expliquer dans mon essai que les deux disciplines, Philosophie et Littérature, sont d’une part très incertaines d’elles-mêmes et de leur objet (contrairement, par exemple, aux Mathématiques, à la Physique, etc.), et que d’autre part, les filières où elles s’enseignent sont des filières de philologie : on apprend à lire et commenter un corpus à conserver, et éventuellement à manier un peu les langues qui permettent d’accéder à ce corpus. Cet enseignement n’est pas nécessairement un échec s’il est considéré pour ce qu’il est – de la philologie – mais si l’on attend de ces formations davantage que d’être philologue, on se trouve déçu.
Du reste, il me semble également que le rapport philologique aux textes limite les capacités de lecture (bien des questions d’interprétation seraient résolues facilement par les étudiants, si on leur donnait un peu de pratique), et perd les “théoriciens de la littérature” dans des problèmes abstraits… Pour proposer un raisonnement par analogie : imagine-t-on former un menuisier simplement par l’observation de meubles en bois, par l’apprentissage de l’intégralité du mobilier de Versailles, et par l’apprentissage d’une procédure à respecter dans l’installation des meubles dans une maison ?
Et, allons plus loin, que donnerait une réflexion, dans le cadre de cette formation, sur “l’essence de la menuiserie” ?
Je dis cela sans détestation de la philologie : j’aime les textes anciens, mêmes latins et grecs, les lire et les interpréter. Je tenais simplement à souligner que cela ne peut suffire à comprendre les textes, ni à savoir comment se servir du langage.

Baptiste Emile Dericquebourg devant la basilique Saint-Just Valcabrède.
Pourquoi, d’ailleurs, associez-vous littérature et philosophie dans l’enseignement universitaire français ?
Il me semble que ce que nous pratiquons aujourd’hui sous le nom de philosophie n’a pas d’identité intellectuelle bien nette, avec un objet bien défini, ou une méthodologie claire. C’est un mélange entre deux activités : une activité philologique (étudier un corpus philosophie, d’ailleurs assez baroque…), et une activité rhétorique : produire des exercices argumentatifs sur telle notion ou tel problème. Ce mélange tient par l’utilisation d’un mot, philosophie, qui a désigné beaucoup de choses au cours de l’histoire, qui est lesté d’un prestige un peu désuet, et qui fait plus écran qu’autre chose.
Quant aux lettres, à l’enseignement de la littérature, j’ai déjà expliqué qu’elles étaient réduites à la partie “philologie”, avec une pratique de la rhétorique restreinte aux questions méta littéraires (en somme, à l’interrogation des notions utilisées dans cette formation : ce sont les dissertations littéraires, exercice intéressant et formateur si on le prend pour ce qu’il est). Les deux disciplines sont en réalité très proches dans leur méthodologie, et beaucoup d’étudiants hésitent d’ailleurs longtemps entre l’une et l’autre. La séparation me semble de plus en plus artificielle, sans être complètement infondée. J’ai donc proposé de renommer ces activités d’après les catégories antiques correspondantes : philologie (étude et commentaire des textes), et rhétorique (générale, car je n’entends pas par là uniquement l’apprentissage à l’écriture de discours, mais à l’apprentissage, technique donc, et actif, à la production de textes en général).
Vous remettez en question la finalité de ces études : la thèse, que vous qualifiez de « marginalia ». En quoi les thèses de littérature n’ont que peu de sens ou d’utilité pour vous ?
La thèse (en philosophie et en littérature) est quasi-exclusivement une activité de commentaire. L’exercice contribue fortement à l’enfermement dans un rapport philologique aux textes, et à la constitution d’un clergé. Avec l’affaiblissement économique des autres professions du livre, ce clergé, aujourd’hui, dispose d’un poids déterminant dans ce qu’est la “vraie littérature”, “la vraie philosophie”, sans pour autant être en mesure d’être productif, inventif. Lorsque l’on finit sa thèse, on a en général une trentaine d’années, et l’on a à peine commencé à vivre autrement que dans la glose… Il y a là une impasse pour la vie des discours, et de la pensée, au sens large.
Pour autant, je souhaite préciser que mon discours n’est pas un jugement de valeur sur toutes les thèses, et j’en lis aussi et y trouve des renseignements et des réflexions intéressantes, comme dans une partie des travaux constituant les “marginalia”. La logique de mon texte, qui tient du pamphlet, m’oblige toutefois à un peu de généralité, pour pointer des problèmes de structure, et des problèmes de finalité.
Vous questionnez le terme d’enseignant chercheur en littérature. En quoi n’est-ce pas, pour vous, de la recherche ?
Il y a bien de la recherche philologique dans les facs de lettres : un modèle dans le genre, c’est l’ouvrage de Dolf Oehler, le Spleen contre l’oubli. Mais il me semble que le sens des textes ne constitue pas un objet de recherche ; au fur et à mesure, quand on n’a d’autre objectif de recherche que de rendre compte d’un texte par la production d’un autre texte, appelant un autre texte, etc., plus ce sens se dérobe : le sens dépend largement de l’action et de l’usage que nous pouvons en faire.
Au delà du constat d’échec, vous abordez l’origine du problème : l’abandon de l’enseignement d’une pratique de l’écriture à l’université à la fin du 19ème siècle. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
S’intéresser à l’enseignement du XIXème siècle conduit à découvrir un monde très différent du nôtre. La pédagogie, sur le modèle antique, est encore largement active, au collège comme au lycée ; la finalité de l’enseignement à ces niveaux reste de former des élites (les autres n’y accèdent pas), donc des gens capables de produire des discours. Les exercices de thèmes, de composition de vers, et de composition rhétorique sont à l’honneur.
Je n’idéalise pas cet enseignement, bien sûr : néanmoins, il est évident qu’il a largement soutenu la créativité littéraire, ne serait-ce que par réaction, en France, tout au long du siècle et encore au début du XXème. Mais plus l’école s’étend, moins elle se donne comme objectif de former à l’utilisation du discours, mais plutôt à la révérence face au discours ; la formation à la production de discours (j’emploie ce mot au sens le plus large possible) se cantonne dans les formations les plus élitistes. Je propose de lier ce phénomène à la contradiction entre un régime représentatif (où l’exercice du pouvoir par la parole est cantonné, dans les faits, à des groupes sociaux restreints) et à la prétendue “démocratisation” scolaire, plutôt une massification de l’accès à l’écrit, assez éloignée d’une formation à l’usage du discours.
L’enseignement de la pratique de l’écriture a été abandonné, selon vous, à la fin du 19ème siècle. Par quoi a-t-il été remplacé et quelles ont été les conséquences ?
Ce sont les exercices orientés vers la lecture qui l’emportent. Le lien entre lecture et écriture n’est plus fait, et l’écriture devient une activité un peu mystérieuse…
Quel a été l’impact de cet enseignement de la littérature basé sur l’analyse de textes sur les élèves et les enseignants ?
Les attentes des uns comme des autres deviennent floues. Étudier quelque chose que l’on ne sait pas faire, et dont on n’a que lointainement une idée du plaisir et des bénéfices qu’il pourrait nous apporter, n’aide pas à susciter le désir. Mais comme les gens sentent bien qu’ils en ont besoin, il arrive assez régulièrement qu’ils aillent chercher ailleurs, par d’autres biais, ce savoir-faire : atelier d’écriture, ouverture d’un blog et animation d’un petit groupe, pratique de l’écriture entre amis, chaînes YouTube, etc.
Étonnamment, vous défendez la dissertation. Pourquoi ?
Il faut prendre la dissertation pour ce qu’elle est : un exercice rhétorique, à partir de l’analyse d’une thèse, et sa discussion contradictoire à partir d’exemples. C’est un exercice actif, mais également analytique, qui impose d’apprendre à composer un propos argumenté – donc une bonne propédeutique. Il faut simplement le prendre pour ce qu’il est. D’une manière ou d’une autre, il faut bien apprendre à composer, en suivant des formes ou d’autres. Je pense qu’en fait, la dissertation a mauvaise presse plus en raison de son isolement (peut-être le seul exercice rhétorique survivant) et des prétentions que certains y mettent (comme s’il s’agissait d’une méthode intellectuelle infaillible) que de ses qualités intrinsèques.
Au delà des élèves et des enseignants, pensez-vous que l’abandon des modèles ait également impacté les écrivains français, qui se sont retrouvés « libres d’écrire sans modèles ni outils » autres que ceux qu’ils découvraient en autodidactes ?
J’ai le sentiment que c’est l’une des causes de la place extraordinaire qu’a pris l’autofiction dans le paysage littéraire contemporain : à défaut de s’inscrire dans la transformation d’un genre littéraire et d’être capable de l’investir de façon créative (parfois révolutionnaire) et de trouver des lecteurs capables grâce à leur propre pratique de l’écriture, de percevoir telle entreprise, on raconte sa vie, plus ou moins fictionnalisée. Les hommages aux auteurs abondent, mais les imitations de techniques sont bien souvent masquées comme telles et souvent inconscientes, et l’obsession de la “sincérité” ou de la “vérité” s’impose partout…
L’abandon des modèles répondait également à l’idéal romantique, d’un état de pureté de l’écrivain, libéré de toute influence extérieure à lui-même. Pensez-vous que l’on puisse apprendre sans modèles ?
Non, absolument pas.
La rhétorique a cessé d’être enseignée en Lettres et en Philosophie au début du 20ème siècle. Son enseignement a-t-il totalement disparu en France ?
Les classes préparatoires littéraires sont, dans une certaine mesure, des formations rhétoriques qui ne se présentent pas comme telles : on apprend largement à écrire et parler, à travers un exercice, la dissertation, et en l’appliquant à différents objets (histoire, lettres, problèmes généraux (=philosophie), sans spécialisation de discipline, sauf en deuxième année. C’est l’un des derniers foyers de l’ancien enseignement rhétorique.
Pour le reste, il y a beaucoup de formations qui enseignent à produire des discours, et s’apparentent largement à des formations rhétoriques, sans toujours l’avouer : on apprend à composer tel type de textes en école de journalisme, tel autre à Sciences Po, ou l’ENA, etc. Mais on notera que ce sont des formations du supérieur et à destinations des classes dirigeantes.
Depuis quelques années, nous assistons à la création de Master d’écriture créative. Pensez vous que ces filières parviennent à transformer les filières littéraires ?
Je les connais trop peu pour apporter une réponse catégorique. Ce qui me gêne, c’est qu’à ce niveau (master), on s’adresse déjà à une extrême minorité des gens…
Vous appelez la disparition des filières de Lettres et de Philosophie. Pourquoi ?
En partie par provocation et par la logique de mon pamphlet ; en partie pour proposer les transformations évoquées plus haut. En réalité, j’appelle à les renommer d’après leur contenu réel : études philologiques. Au moins, on serait au clair sur ce qui s’y pratique. Mais il me semblerait souhaitable que l’enseignement rhétorique sorte de son isolement et soit dispensé dans de nombreuses formations…
Par quoi devraient-elles être remplacées selon vous ?
Pour le supérieur, j’ai répondu. Pour le secondaire, qui est le niveau crucial pour la vie d’une nation, par un ensemble cohérent d’heures de lecture, d’heures d’apprentissage de la langue et d’heures de rhétorique générale.
« Le deuil de la littérature » est féroce. Votre livre a-t-il provoqué des réactions ?
J’ai eu un certain nombre de retours, oui. Beaucoup de rires, apparemment, c’est déjà ça. Ma proposition de pédagogie active n’est pas toujours prise au sérieux, je le regrette, peut-être que le mot n’est toujours pas disponible pour sortir du purgatoire… Mais beaucoup de remerciements d’avoir posé ces problèmes avec courage et franchise, ce qui me conforte dans l’idée que poser ces questions de façon à travers un pamphlet était chose utile, voire nécessaire. Toutefois, je dois préciser que j’ai eu de bons professeurs, bienveillants et attentifs, qui m’ont beaucoup appris au cours de mes études : je regrette de leur paraître peut-être ingrat par mon texte… mais un pamphlet exige, pour avoir sa force, d’être un peu aveugle et de “tirer dans le tas.”
Une dernière question : techniquement, votre livre doit beaucoup aux modèles littéraires que vous avez étudiés. Comment avez-vous fait pour vous autoriser à digérer ces modèles et à ne pas sombrer dans les « marginalia » ?
Ça a été un long parcours, entre la pratique de l’écriture, le dégoût des bibliothèques et des colloques, la fréquentation des Grecs depuis longtemps, beaucoup de conversations enrichissantes avec mes amis, mais l’éloignement volontaire d’avec le monde universitaire…
L’enseignement de l’écriture est un sujet au cœur du projet Les Artisans de la Fiction. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous invitons à lire les interviews suivantes :
Pourquoi a-t-on cessé d’enseigner l’écriture dans l’université française à la fin du 19ème siècle ?
La différence d’enseignement de la littérature entre la France et les pays anglo-saxons
Yves Lavandier : l’importance des modèles narratifs
Interview : Lionel Tran – Mise en forme : Roxane Fallot.
Remerciements à Flavien Gache pour avoir attiré notre attention sur « Le deuil de la littérature »